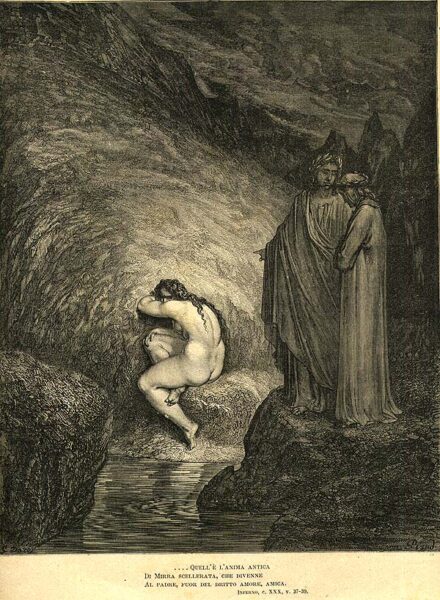Comme nous l’avons vu dans l’article précédent, Les Deux étendards sont l’histoire d’une opposition. L’opposition implique le conflit et, in fine, la crise. Puisque l’opposition qui tiraille toute la narration de l’œuvre de Rebatet est axée autour d’un triangle amoureux, cette crise s’accomplit en plusieurs temps – l’auteur envisage toutes les possibilités. Elle concerne d’abord Michel seul – la pièce rapportée – puis Régis et Anne-Marie. L’auteur, qui maîtrise à la perfection tous les codes narratifs, joue avec ces derniers pour créer de subtils chiasmes et parallélismes qui donnent au récit une couleur à la fois ironique et mordante, typique de la tradition littéraire française.
1. La crise de Michel (la fuite vers l’ordre)
On s’en souvient, Régis avait fini par convaincre Michel d’aller consulter un Jésuite. Si l’entrevue s’était avérée édifiante, elle avait cependant tourné autour de la littérature plutôt que de la foi. Régis n’est pas satisfait ; il bout : il attend avec impatience, presque frénésie, la conversion de son ami. Il finit par le rediriger vers un autre Jésuite, le père Chaleyssin :
Le Père Chaleyssin était un grand prêtre de quarante-cinq ans, avec une grande figure d’une distinction plus littéraire qu’ecclésiastique, des lunettes à monture d’or, un immense front chauve et une couronne de cheveux à l’artiste. Seul, son teint de bougie dénonçait une santé défaillante. Il recevait Michel dans une chambre spacieuse, bien cirée, bien tenue, commodément meublée, presque entièrement tapissée de livres. […] Sur une question distraite du prêtre, Michel confessait son démon littéraire et l’influence immodérée sans doute que Gide et Nietzsche avaient prise sur lui.
Gide et Nietzsche, que l’on retrouve tout au long du roman-fleuve de Rebatet, ne sont pas cités au hasard. Ils englobent toute l’idéologie d’un auteur contesté s’étant revendiqué du fascisme, et ayant eu une pensée politique que l’on pourrait qualifier d’anarchisme de droite : rejet des formes sociales héritées de la révolution industrielle, et culte du chef militaire. Gide symbolise le rejet social : il est le protestant révolté. Nietzsche représente quant à lui le culte du surhomme.
L’expérience de Michel avec ce nouveau Jésuite est catastrophique. Le père l’emmène à la confession ; pour Michel, c’en est trop : entièrement pris dans le filet d’une norme sociale d’autant plus incompréhensible pour lui qu’elle est mystique, il se débat avec fureur et sort de l’hypnose dans laquelle il a failli sombrer. Sa décision est prise et semble irrévocable : il va quitter Lyon et toute cette folie.
[Michel] ranimerait ses ambitions de créateur, si ridiculement mises sous le boisseau religieux : « Je ne suis pas catholique : je ne serai pas non plus médiocre. » Il avait rouvert quelques livres profanes. Après trois mois d’abstinence, dix lignes, même d’un auteur réputé sec jusqu’ici, le rafraîchissaient délicieusement.
Justement, comme si la Providence avait de l’humour – ou voulait le tenter –, Michel croise à Lyon Vignon, un ancien camarade qui est journaliste à Paris. Ce dernier lui propose de revenir travailler pour lui à la capitale et d’obtenir enfin la gloire littéraire tant recherchée. La tentation est grande… Comme Balzac dans La Femme de trente ans, l’auteur-démiurge essaie de sauver son personnage – en l’occurrence, son propre double littéraire – qu’il voudrait, peut-être inconsciemment, doter d’une certaine autonomie. Hélas, Rebatet, comme Balzac, maîtrise l’art de tisser un récit et sait jouer avec ses créatures. Aussi dans un premier temps tire-t-il jusqu’au bout la corde du sauvetage :
– Mon vieux, puisque vous prenez les devants, je vais être franc. Si un garçon comme vous n’est pas venu dans ce patelin pour épouser une fille de soyeux, ce qui me paraît peu probable dans votre cas, qu’y fiche-t-il ? La question me brûle la langue depuis cet après-midi. S’il ne s’agit que de gros sous, je me fais fort de vous trouver de l’embauche, et vite. Je ne dis pas que vous n’aurez qu’à vous présenter. Mais vous devez savoir qu’André Lhote a répondu à votre papier sur Renoir dans l’Amour de l’Art, avec de grands coups de chapeau.
– Je ne sais rien.
– Vous êtes vraiment un type ! Et le père Gide en personne m’a parlé de votre Catherine Paterson.
– Gide ! Sans blague ?
– Sans aucune blague. À vrai dire, je lui en ai parlé le premier. Mais il l’avait lue et remarquée. Il regrettait que vous ne l’ayez pas donné à la N.R.F.
[…]
Les images, fouettées par le vin se succédaient à une vitesse extravagante. Quatre mille balles par mois ! C’est le paternel qui en ferait une tête. Le fils vagabond qui gagnerait presque autant que lui ! Il allait retrouver son bon tailleur de la rue Gay-Lussac, se faire lever aussitôt un pardessus neuf que les bousilleurs de par ici ne seraient jamais foutus de couper. Gide avait lu Catherine Paterson : il pourrait se présenter chez Gide. Il écrirait sur la peinture, il serrerait trente mains à minuit, au Dôme ou à la Rotonde. Il irait dans les ateliers voir les peintres, les modèles.
Michel va partir. La narration semble devoir s’arrêter là. Le lecteur, lui, sait qu’il n’en sera rien : Rebatet sait qu’il n’est pas dupe et prend les devants par une habile prolepse narrative en simulant, avec ironie, une fin que l’on sait impossible :
La conclusion était banale et prévisible ? Dans les faits peut-être, mais non pour l’esprit. Michel venait d’entrevoir que son départ, sur la défaite de Dieu, pourrait faire un magnifique épilogue à un livre qui serait l’œuvre, cette nébuleuse enivrante et désespérante, brassée pendant tant de nuits, abandonnée mais jamais absente de sa pensée, et qui prenait tout d’un coup sa forme. Un rêve venait de mourir, un autre renaissait. La boucle était bouclée, le scénario accompli : Puisqu’on avait du talent, eh bien ! on allait raconter une fameuse histoire, avec des replis, et des couleurs, et des thèmes qui en vaudraient la peine, et des cœurs mis à nu comme ils ne l’avaient jamais été, et la face de Dieu et tout le tremblement. On allait mettre un peu cette petite facétie-là sur la route du siècle.
En pénétrant dans sa chambre, Michel se demandait si ce n’était pas d’abord dans l’inconscient dessein de pouvoir un jour l’écrire qu’il avait aussi passionnément voulu vivre cette histoire.
Le lecteur s’y attendait, la suite est « banale et prévisible » : mais ce n’est évidemment pas celle de l’ironique auteur. Dans un second temps, Rebatet rappelle violemment au lecteur et aux personnages qui s’étaient presque échappés du piège narratif qu’il est seul créateur de son œuvre, et que la liberté est invoquée avec dédain, parce qu’elle n’est que factice. Michel revoit Anne-Marie, cela suffit pour raviver son amour, il ne cède finalement pas à la tentation parisienne et décide de rester à Lyon. De nouveau, voici Michel « fait comme un rat ». De nouveau, le voici à l’œuvre, en train de chercher furieusement, par le biais de la lecture et de l’écriture, une porte de sortie à sa condition misérable. Bis repetita, au milieu du livre s’amorce un second livre où tout, pour le plus grand malheur des personnages qui semblent évoluer dans un monde infernal, semble recommencer à l’identique. Cet arrêt brutal dans la tentative de fuite de Michel se traduit, narrativement, par un arrêt brutal de ce qui fait l’essence de la littérature : l’expression d’un message. Et c’est ainsi que Michel se heurte, de nouveau, aux limites du langage.
Jamais la littérature d’autrui ne m’a plus tragiquement découragé. Dans quel sens retourner à son tour les mots pour parvenir à les faire siens ? J’ai essayé de travailler pour dominer, au moins à mes propres yeux, ma calamiteuse condition. J’aurais voulu donner une forme arrêtée et parlante à cette nostalgie de Paris qui frissonne, qui remue perpétuellement en moi. Je voudrais en saisir les couleurs, les odeurs, les sons. Hélas ! Comment exprimer l’amour de Paris sans déchoir à la plus fade romance ? Comment dire cette horreur que m’inspirent le nasillement bienheureux de Régis, le catholicisme, ses fausses monnaies, ses orémus et ses extases ? Cependant d’autres, après des milliers d’autres, l’on pu. Le vieux silex français donne encore et donnera des étincelles. Pour le battre, mes mains sont-elles trop inexpertes ou déjà trop lasses ? N’est-ce pas une imbécile présomption que de vouloir à la fois poursuivre cette aventure et s’en arracher la substance toute palpitante ? On doit choisir : vivre ou créer. Je suis dans l’époque de la vie.
Michel, un peu hargneux, un peu méprisant, agacé autant que son créateur par les injonctions des normes sociales, imagine la vie qu’il aurait eue s’il avait fait semblant de croire pour plaire à Régis – et, surtout, à Anne-Marie. Cette fois-ci, ce n’est plus l’auteur qui l’imagine, mais le personnage lui-même. Dépité, il arrive, bien naturellement, à une conclusion similaire à celle de son double – l’auteur.
Au lieu de ma pauvre et peccamineuse Catherine, insortable dans la société des bien-pensants, je produisais pour la N.R.F. une grande nouvelle poétique et suffisamment déclamatoire sur le « message de Brouilly », moitié Du Sang, de la Volupté, moitié Annonce faite à Marie. Je dédiais à Claudel ce beau morceau soufflé et sucré à point. Régis se décrochait les entrailles d’admiration et d’émotion. Je fréquentais les Pères de l’Église non pas en pécheur inquiet de son salut, mais en amateur distingué de « valeurs spirituelles », toisant avec un souriant mépris les hégéliens, nietzschéens, positivistes, pragmatistes et autres sans-Dieu en déroute. Je proclamais la « primauté » humaine, sociale et philosophique de Thomas d’Aquin et d’Ignace, seuls vrais maîtres de tous les « ordres de grandeurs ». (Les pluriels inusités sont toujours du meilleur effet.) Pour le reste, j’exécutais des solis raffinés, des arabesques en points d’interrogation. « Peut-être. » Pas un mot de plus. Quelle fortune ! Quel triomphe ! On s’arrachait ma prose, dix revues néo-catholiques s’ouvraient à moi, j’en fondais une en daignant fixer ici mes pénates. Je conférenciais. Je devenais une des voix de la génération montante, un jeune penseur, déjà beaucoup trop haut perché pour qu’on se permît sur lui les manœuvres de racolage bonnes pour les vulgaires conscrits, mais servant très heureusement la cause dans un secteur littéraire où les « témoignages » chrétiens n’abondent pas. Avec deux doigts de politique, soit maurrassienne, soit socialisante, peu importe laquelle, mais considérée des sommets, et d’autant plus impérative qu’elle est plus nébuleuse, je devenais un roi.
Le voici, à sa plus grande horreur, traîné de force à la suite des chantres de l’ordre religieux et social, Thomas d’Aquin, saint Ignace, Claudel et Maurras. Cela pourtant relève du plus pur fantasme : car nous savons déjà que Michel, comme Rebatet, n’est pas un conservateur mais un anarchiste, qui refuse de se conformer au moule de la société moderne, et qui s’y refuse d’autant plus qu’on veut le lui imposer. D’où une conclusion générale et sentencieuse qui vient mettre un terme à la crise de Michel : celle d’une tentative de fuite vers l’ordre.
Ma loi n’est pas celle du troupeau. Elle est infiniment plus difficile à déchiffrer. Pour ceux de ma race, c’est la rançon de notre noblesse.
2. La crise de Régis et d’Anne-Marie (le piège de l’ordre)
Le roman a bien failli s’arrêter par la mort morale de Michel ; c’était oublier que Michel est le double littéraire de Rebatet, et Rebatet n’est pas suicidaire. Maintenant que Michel a combattu la crise et s’est affirmé (« Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. »), Rebatet va pouvoir donner libre cours à sa vengeance.
Régis est en ligne de mire. Là encore l’auteur, créateur tout puissant et assez cruel, va s’amuser et jouer avec les codes de la littérature pour creuser une nasse mortelle autour d’un personnage qu’il déteste. Cette fois-ci, point de salut : Régis n’est pas son double. Perversité de l’écrivain, Régis, ce fanatique de l’ordre religieux, va tomber dans son propre piège : un Jésuite, ayant découvert son idylle, lui enjoint de rompre immédiatement. Régis n’a pas le choix ; il est dévasté, mais il obéit. Michel et Anne-Marie sont fous de rage.
Avec Régis, le rite de la bibliothèque s’était rétabli vaille que vaille, fournissant à Michel le remords de différentes petites lâchetés. Il s’arrêtait vers huit heures du soir devant la maison des Lanthelme, pour y prendre Régis, avec le même fatalisme nauséeux que l’alcoolique qui se tue chaque jour en ingurgitant parmi les mêmes imbéciles des apéritifs écœurants. Il n’osait plus consulter les volumes de la section religieuse, maintenant que Régis savait le damnable usage qu’il en pouvait faire. (« Magnifique ! Je peux fourrer mon nez dans n’importe quelle obscénité, l’autre ne fera qu’en sourire. Mais les plus orthodoxes commentaires de l’Évangile deviennent pour moi de mauvaises lectures, parce que je ne m’y promène pas dans l’unique sens autorisé. Le plus fort est qu’ils ont raison, selon leur boutique. Ils sont les gardiens de la Parole, le laïc ne la doit connaître que par les tranches qu’ils en découpent. Je n’ai jamais mieux compris leur répugnance à divulguer la Bible. ») Il soupirait après les gros bouquins austères, hérissés de chiffres, de références grecques, semés de mots biscornus, il en avait une nostalgie fringale, comme naguère des Renoir les plus chatoyants, des plus capiteuses musiques. Il s’ennuyait, cherchait de hasardeux dérivatifs dans la collection des Études, que Régis ne pouvait tout de même pas proscrire.
Michel, qui rejette l’ordre, avait tenté de fuir vers l’ordre : c’était un piège. Régis, qui est l’ordre incarné, tombe dans le piège de l’ordre. Rebatet a réussi le chiasme narratif parfait. Michel (ou Rebatet), revigoré, profite de la faille du couple ; il agite devant Anne-Marie son étendard, celui du Démon ; il commence par lui avouer son agnosticisme –
– Eh bien, le christianisme n’est pas de mon goût.
– Michel ! Pourquoi plaisantez-vous, pourquoi vous esquivez-vous par une gambade, alors que vous me noyez dans le plus affreux désarroi ?
– Mais je vous jure que je ne plaisante pas. Le mot n’est d’ailleurs pas de moi, presque textuellement, il est de Nietzsche. Nietzsche en fait la conclusion d’une immense enquête. Il estime qu’il ne saurait mieux exprimer ses raisons les plus valables, les plus profondes. Je suis de cet avis, et je me permets d’ajouter que les chrétiens ne peuvent rien nous opposer de plus sérieux.
– et rallie de plus en plus Anne-Marie à ses idées :
– Les plus grands saints se sont donc tous laissés tromper ? Même saint Jean de la Croix… Ce pauvre petit Carme, si courageux, si pur…
– Ce fut un grand homme, je le vénère, je le défendrais contre des millions d’imbéciles.
– Dire que c’est vous qui m’avez appris à l’aimer, qui me l’avez peut-être le mieux fait comprendre ! Et vous me déclarez maintenant que c’était un songe-creux.
– Il a su décrire une belle aventure, dans de très beaux vers.
– Des vers que vous disséquez comme des lapins cancéreux, s’écriait Anne-Marie en remettant son manteau, car il se faisait tard.
– Ma chère amie, vous me concéderez, j’espère, que, si peu que je sois artiste, je le suis tout de même infiniment plus que médecin. L’artiste, soyez-en sûre, préférerait croire que saint Thérèse a bien connu le roman de l’amour divin, que le poète Jean de la Croix est bien monté jusqu’à Dieu au sortir de la nuit obscure.
– Vous, artiste ? Oui, mais vous seriez fort capable d’apprendre la biologie statistique, de vous faire chirurgien pour pouvoir nier ce qui vous gêne… Ce qui est terrible, c’est que je vous entende si bien, malgré tout le déplaisir que j’en ai !
Les Deux étendards, c’est une histoire de la littérature ; elle est le quatrième personnage principal qui couvre de son ombre Michel, Anne-Marie, Régis mais aussi Guillaume et les autres acteurs secondaires qui forment le grand tableau wagnérien de Rebatet. C’est pourquoi Michel, si près du but, use naturellement de son alliée la plus puissante pour séduire enfin sa proie.
Michel lisait à Anne-Marie, dans la petite salle du café des femmes, quelques pages de Thomas Mann qu’il venait de se rappeler et qui pouvaient inciter à de piquantes et peut-être enivrantes analyses. Le garçon usait sans vergogne de ces secours littéraires. La littérature était une seconde vie.
« Une seconde vie. » Michel, sans pitié, compte bien détruire en totalité la relation mystique d’Anne-Marie et de Régis. Ce dernier n’est pas dupe : la confrontation finale, le choc des contraires, est désormais imminent.
3. À la conquête d’Anne-Marie (le biais littéraire)
Tandis que Régis et Anne-Marie sont en rupture, Michel, le païen, est en veine : la déesse littérature a décidé de l’aider. La littérature, cette arme de séduction, c’est la lecture et l’écriture. Le héros, on s’en souvient, a déjà commencé à séduire Anne-Marie en lui parlant de ses lectures ; il lui fait maintenant lire ses propres écrits pour l’éblouir.
Anne-Marie, fort intriguée, partit aussitôt avec les deux chefs-d’œuvre. Elle revint le lendemain en disant qu’elle les avait dévorés incontinent. L’article sur les peintres lui inspirait certainement plus de respect que d’enthousiasme :
– Je suis tout à fait ignorante dans ces choses, et vous très savant. Vous en savez encore plus que je ne croyais. On mangerait de vos métaphores, et vous donnez envie de voir des tableaux.
Mais Catherine Paterson l’avait autant surprise qu’amusée et touchée.
– Et vous n’avez rien écrit depuis ? Vous êtes un monstre. Très franchement, Michel, je ne vous croyais pas capable de ça. Vous avez un talent du diable, un pittoresque fou ! Votre Catherine est charmante. Vous m’avez fait rire et vous m’avez émue. Vos personnages m’ont presque fait oublier que c’était vous l’auteur… Mais vous êtes le plus ignoble paresseux. Vous allez me faire le plaisir de vous remettre au travail, et tout de suite. Votre fortune est dans votre encrier, nulle part ailleurs.
Il fit tous les serments. Le plaisir d’auteur s’ajoutait à la joie de marquer devant Anne-Marie un point si important. Le jeu reprit ce soir-là, enivrant. Michel rentra chez lui, tout étourdi.
Hélas ! les avantages littéraires sont d’un faible poids dans l’amour. Dès le lendemain, Anne-Marie arriva tout occupée de sa dernière répétition de comédie.
La littérature est le seul ordre qui puisse convenir à Rebatet. Michel, comme l’auteur, va utiliser ce biais pour se raccrocher tant bien que mal à une société qu’il ne comprend pas et à laquelle il ne parvient pas à se greffer. Wagner et la littérature sont les deux cadres qui structurent tout le récit des Deux étendards. Wagner est presque toujours le point de rencontre des personnages et des situations ; la littérature est souvent le moteur de l’action qui s’ensuit. Rebatet utilise, consciemment ou non, des parallélisme narratifs pour faire progresser le roman. Ainsi, Michel et Guillaume découvrent la vie parisienne en même temps que Proust. Michel écrit une première fois au moment où il se lance dans une carrière parisienne. Puis il théorise sa relation à Régis et Anne-Marie en même temps qu’il s’abreuve de lectures, et ses dépits amoureux sont toujours corrélés à des dépits littéraires.
Proust, en même temps que Nietzsche et Gide, est une grande source d’influence pour le héros. Lorsque la déesse Littérature semble l’avoir abandonné, il relit l’auteur de la Recherche. Il songe nécessairement à Régis, et à sa propre histoire, en lisant ces lignes éternelles et prophétiques.
… Plus d’amour. Ces écrivaillons l’ont biffé d’un trait de stylo. À quoi bon se soucier d’eux ? … Mais d’autres aussi, qui étaient grands et profonds, ont vu la vanité de l’amour, Proust, l’admirable Proust !… « L’amour le plus exclusif pour une personne est toujours l’amour d’autre chose. » Que de temps écoulé depuis que Michel n’a pas relu ces paroles amères et calmes, qui sont peut-être la seule sagesse !… Une autre : « Si nous n’avions pas de rivaux, le plaisir ne se transformerait pas en amour. »
Désespéré de constater que son aventure avec Anne-Marie est au point mort, Michel comble son vide intérieur par l’écriture. Le voici donc, encore et toujours, écrivain maudit. Mais la littérature, comme depuis l’incipit, est intimement liée aux relations interpersonnelles des différents personnages : et c’est pourquoi l’écriture de Michel, pas plus que sa conquête d’Anne-Marie, ne parvient à atteindre son but.
Il entama un conte psychologique sur les premiers pas à Paris d’une petite provinciale pieuse et vierge, son ahurissement, les périls qu’elle se figurait, sa rencontre de l’amour et sa chute, déterminée par une maladroite invention de sa vertu même. Le projet, né depuis l’automne, avait eu tout le temps de mûrir. Michel avait même caressé plusieurs fois assez tendrement les traits hésitants de son infortunée Angèle : « Beau cadre pour décrire une chute vers le putanat. Angèle ne descendra pas au-dessous de cinquante francs. On peut cependant s’inspirer de certains bruits et de certaines odeurs. » Mais la verve ne venait pas. Michel hésitait dans ses impressions parisiennes, il n’était plus aussi certain que l’histoire d’Angèle se dégageât des poncifs de la prostitution, et que le scabreux du sujet ne fût pas tout vulgairement du mauvais goût : « Province, province… A Paris, mille liens invisibles vous rattachent à toute la littérature qu’on y a remuée, suée, sécrétée depuis la Ballade des Pendus. Où en sont-ils, là-haut, maintenant ? Je ne sais plus. L’air ne porte pas dans cette sacré nom de Dieu de ville-ci, on n’y respire pas les idées, mais les chiffres et les orémus. Elle n’a qu’une poésie, sa sensualité, mais rien pour la faire lever. »
Michel fait toutes les folies pour Anne-Marie. Il la suit jusqu’en Suisse :
Anne-Marie avait enfin lu les Karamazov dans la traduction complète, elle avait picoré avec appétit dans plusieurs tomes dépareillés de Voltaire, les seuls livres français de la pension Fischer : elle avait lu les Lettres philosophiques avec les remarques sur les Pensées de Pascal. Michel fronçait le sourcil – comme les eût, ma foi ! froncés Régis. – Il ne lui plaisait guère qu’Anne-Marie fréquentât un incroyant aussi novice. Voltaire et Dostoïevski : le génie n’était pas chez le mécréant mais chez le chrétien, chrétien sans foi, combien chrétien cependant. Et puis Voltaire parlant des Pensées…
Michel trouve du réconfort dans Dostoïevski, qu’on ne s’étonnera guère de retrouver dans sa bibliothèque personnelle. Les Frères Karamazov est presque le frère jumeau des Deux étendards. L’œuvre de Dostoïevski, qui pourrait être lue en même temps que celle de Rebatet dans le cadre d’une belle lecture à thème, aborde presque tous les problèmes auxquels sont confrontés Michel, Régis et Anne-Marie.
– Vous êtes un personnage étonnant ! dit Anne-Marie. Vous m’interdisez la Vie de Jésus de Renan – je l’ai lue quand même à Lyon…
– Une sirupeuse vie romancée, le premier exemple du plus vulgaire et du plus faux des genres littéraires.
– … Mais vous me faites lire les Karamazov, un livre pétri de christianisme. Et vous voulez qu’en le fermant, je dise adieu au Christ.
– Je vous ai fait lire les Karamazov par amour de la littérature, de l’art, et pour vous épargner l’envie de lire les petits romanciers. Vous êtes beaucoup trop déliée déjà pour ne pas savoir vous détacher du sens moral d’une grande œuvre. Il se trouve que les Karamazov sont une œuvre chrétienne, mais gigantesque et belle. Comme l’Érection de la Croix et la Descente de Croix de Rubens, par exemple. Je vois chez Rubens de magnifiques et pathétiques géants, autour d’un beau crucifié. Peu m’importe si Rubens a cru que ce crucifié devait ressusciter. Nous sommes sortis du christianisme : claquons la porte derrière nous. Ayons le courage de notre mécréance ! Rien de plus détestable que ces athées comme Ivan Karamazov, qui demeurent obsédés, habités par le Christ. Quelles chiffes ! quels décadents ! Trop lâches pour croire, trop lâches pour nier.
– Vous préférez Aliocha ?
– Bien entendu, comme Dostoïevski, comme vous, et nous avons raison. Mais vous, il ne vous faut plus envier à Aliocha sa foi. Anne-Marie, vous me disiez tout à l’heure que je vitupérais la vie incompréhensible et cruelle. Je me suis mal exprimé sans doute, j’en avais surtout contre les hommes. Je commence à comprendre que les hommes ne sont pas tellement victimes d’une absurdité cosmique, métaphysique, extérieure à eux, et qu’ils subiraient dans la douleur et les ténèbres : l’absurdité est en eux, ils en sont les artisans, et leurs dieux sont des formes de cette absurdité. Je pense, Anne-Marie, qu’en soi, la vie est bonne et belle.
La littérature n’a pas qu’une influence sur le plan métaphysique et religieux pour Michel et Anne-Marie. Sur le plan politique aussi, Michel suit ses idoles littéraires ; Nietzsche, bien sûr, est l’une des principales références du héros – et sans aucun doute de l’écrivain Rebatet. Les pages du Gai savoir sur l’Absence des formes nobles sont édifiantes. Le philosophe y écrit : « Provisoirement du moins, toute civilisation à base militaire se trouve bien au-dessus de tout ce que l’on appelle civilisation industrielle : cette dernière, dans son état actuel, est la forme d’existence la plus basse qu’il y ait eu jusqu’à présent. » Et encore : « Les fabricants et les grands entrepreneurs du commerce ont probablement beaucoup trop manqué, jusqu’à présent, de toutes ces formes et de ces signes distinctifs de la race supérieure, qui sont nécessaires pour rendre des personnes intéressantes ; s’ils avaient dans leur regard et dans leur geste la distinction de la noblesse héréditaire, il n’existerait peut-être pas de socialisme des masses. »
Michel se retrouve pleinement dans cette idéologie, à mi-chemin entre l’aristocratisme libertaire et l’anarchisme féodal.
Anne-Marie le dévisageait avec étonnement :
– Mais, mon ami, voilà que vous me parlez politique, maintenant !
– Oh ! Politique !… ma chère, lisez le Gai savoir, page sur l’Absence des formes nobles. Ma politique y tient entièrement.
– Alors, tant pis. Je la croyais au moins un peu plus originale !
Ah ! le lourdaud ! Lourdaud livresque !
Le « lourdaud livresque » ne fait pas encore fuir Anne-Marie. Il l’aide à préparer son bac ; et en profite pour la convertir, elle aussi, à Stendhal qu’admirent Michel et Rebatet :
Michel imposa la vertu à ses yeux et rassembla autant d’esprit qu’il pouvait pour vivifier les carrières des Thiers et des Molé, coudre à des souvenirs littéraires les lois et les débats des pairs. Mais ils étaient passés depuis un temps indéfini du ministère Guizot aux balancements amoureux de Lucien Leuwen. « Un peu agaçants à la longue, estimait Anne-Marie, et un peu trop naïfs. – Non pas ! d’une vérité admirable en tout, Stendhal a osé dire ce que tant d’autres cachaient » quand Michel feignit d’apprendre avec confusion qu’il était six heures et demie sonnées.
Michel sent qu’approche le but. Il n’est maintenant plus qu’à un cheveu de l’amour d’Anne-Marie. Il ne lui reste plus qu’à franchir le Rubicon.
4. La bataille décisive (conclusion)
Michel, enfin, avoue son amour à Anne-Marie. Pour cet acte qui correspond au point culminant de l’œuvre, Rebatet s’aide de l’un des plus grands auteurs de la littérature française, déjà découvert par Michel au début du livre lors de son arrivée à Paris – la boucle est bouclée par un habile parallélisme d’ouverture et de clôture.
– Vous rappelez-vous, dit Anne-Marie, une petite scène de Proust : le prétexte des cattleyas, quand Swann voulait se rapprocher d’Odette ?
– Je me rappelle, Anne-Marie. Mais ne savez-vous donc pas qu’en ce moment, devant vos yeux, je vis cela moi-même ?
– Michel !… que dites-vous donc ?
– Ah ! vous savez bien ce que je veux dire. Entendez cela comme l’aveu d’un pauvre bougre… Anne-Marie… comme son aveu complet… Vous aurez parfaitement entendu.
Ainsi, tout était fait.
L’aventure d’Anne-Marie et de Michel est parfaite. Enfin, ce dernier trouve la force d’écrire. Au plus fort de son bonheur, c’est dans le théâtre qu’il décide de se plonger ; une décision surprenante – il n’a presque jamais été question de théâtre depuis le début du récit – qui accompagne une action surprenante – la soumission totale de la pieuse Anne-Marie à « l’étendard du diable ».
Michel se levait constamment, arpentait la pièce, faisait le tour de la terrasse, revenait piquer quelques lignes sur sa feuille, se relevait, se plongeait brusquement dans un de ses cartons, parcourait et cochait de vieux papiers, repartait dans sa promenade.
– Quel manège, Michel !
Il la saisit par la taille.
– Ma petite Anne-Marie, je suis en plein boulot. Je crois que je tiens une idée. Je ne l’ai pas aujourd’hui, je l’ai encore pelotée la semaine dernière, avant Nice. Mais elle a maintenant ses arêtes définitives. Et les idées ruissellent autour. Imagine-toi ça ! c’est une pièce de théâtre. Quelle bizarrerie : du théâtre ! ce que je connais le moins bien, ce qui m’a certainement le moins attiré, durant tout le temps de Paris. Cependant, j’en suis sûr, cela ne peut être que du théâtre. J’ai le théâtre aujourd’hui en assez piètre estime. Mais quand une pièce est belle, ma chérie, quand elle est d’une étoffe durable, c’est le sommet de la littérature. Bon Dieu ! je craque. Mes idées ne tiennent plus dans ma peau. Ah ! l’amour me réussit !
Michel, comme toujours, a la folie des grandeurs. Il veut faire une pièce sur un Jésuite sans la foi, un pur inquisiteur : il veut, en bon anarchiste, casser tous les codes sociaux :
– Oh ! Michel, c’est épatant. Mais tu veux mettre ça au théâtre ?
– Pourquoi pas ? Je me sens fort capable de bâtir sur cela un personnage craquant de vie… Un personnage du reste épisodique. Car je veux parler de l’amour. Comment n’en parlerais-je pas d’abord ? Ah ! On va leur faire voir un peu, à tous les débitants, comment on peut apporter de la poésie et des idées au théâtre, sans que la poésie ait l’air d’un affûtiau et l’idée d’un sermon. C’est une grosse histoire à construire. Je ne m’humilierait pas à travailler sur mesures pour messieurs les directeurs, à me recroqueviller en trois petits actes. J’en ai sans doute pour six mois à tout mettre debout. Tant mieux ! Vive Loyola ! Vivent les grandes tâches. Six mois de travail près de toi ! Je me sens invincible.
– Quelle confiance tu as en toi ! dit-elle. Où est le Michel tortillé et emberlificoté des petits cafés ? Comme tu vis ta littérature ! C’est une autre vie que tu te donnes.
– Mais c’est de toi que je la tiens. Je ne te quitte pas une seconde…
– Tu n’as pas besoin d’expliquer. Je sais. Je ne suis pas jalouse.
La liaison, hélas, fait scandale. La pression familiale est trop forte ; Anne-Marie prend soudainement conscience qu’elle ne sera jamais heureuse avec Michel, car la foi chrétienne est trop ancrée en elle… c’est la rupture.
J’ai eu de toi des plaisirs délicieux et profonds, que je ne retrouverai certainement avec aucun autre. Tu as été, toi aussi, « le premier » pour tant de choses. Mais il ne faut pas, mon chéri, forcer le ton de notre musique : cela deviendrait une parodie. Nous n’avons déjà que trop joué faux. Et pour notre malheur, nous avons tous deux l’oreille juste.
Stendhal, Proust, Nietzsche, Flaubert, Villon, Baudelaire, Gide, Dostoïevski, et tant d’autres… En 1969, Rebatet écrivait une grande Histoire de la musique, sommet d’érudition. Certains diront qu’il manquait l’histoire de la littérature : nous répondrons qu’elle figure dans Les Deux étendards.
Lecture conseillée :
- Les Deux étendards, L. Rebatet, 1952