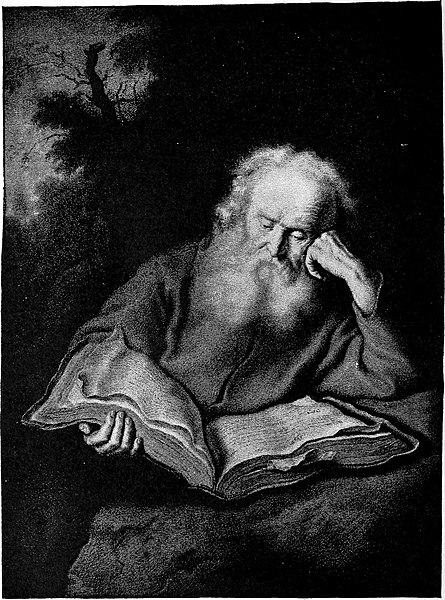… anglais jusqu’au fond, étrange et incompréhensible pour quiconque n’a pas étudié le climat et la race…
[…]
… cette lenteur et cette froideur de la sensation qui l’empêchent de tomber violemment et facilement sous l’empire du plaisir sensible, cette rudesse du goût, cette irrégularité et ces soubresauts de la conception, qui arrêtent en lui la naissance des belles ordonnances et des formes harmonieuses, ce dédain des apparences, ce besoin du vrai, cette attache aux idées abstraites et nues, qui développe en lui la conscience au détriment du reste…
H. Taine
Je ne sais plus à quelle occasion j’entendais Emmanuel Todd évoquer la violence du peuple anglais, et remettre en question ce cliché bien ancré du Britannique interrompant la bataille à cinq heures pour aller boire son thé. Certes, le Royaume-Uni, peuple des brumes aux origines résolument celtes, a connu dans son histoire des divisions terribles, et la brutalité des Anglais m’a frappé tandis que j’étudiais l’histoire de leur littérature. Leurs puritains ridiculisent nos jansénistes — songez donc que ces gens ont porté aux nues Oscar Wilde, avant de le condamner de la plus ignoble des façons, pour une raison qui en France n’eût fait que déclencher des calembours.
Il n’y a pas que la brutalité des Anglais qui m’a frappé, si l’on s’arrête à la littérature. Ils cultivent aussi une philosophie fort éloignée de la nôtre. J’écrivais dans un article récent (lien), sur les différences entre nos traditions, que « le type anglais ne goûte guère notre rationalisme exacerbé », et que c’est plutôt l’empirisme qui les gouverne. Cela se ressent même dans leur histoire littéraire : là où nous séparons la nôtre en mouvements théoriques (l’humanisme, le baroque, le classicisme, le romantisme,…), eux ne la divisent que par périodes historiques, et plus prosaïquement encore, par règnes : la période élisabéthaine et jacobéenne, la Restauration, le dix-huitième, l’époque victorienne, etc. Aussi ne s’étonnera-t-on point que les Anglais, contrairement à nous, ne s’embarrassent guère de manifestes et autres révolutions conceptuelles : leurs auteurs se suivent dans le temps, simplement. Puis, leurs controverses ne sont pas les nôtres : la France a débattu sans fin de la nature de l’homme, les pessimistes s’opposant aux optimistes. Vaste théorie ! — nos voisins d’Albion, s’ils nous dépassent dans l’imaginaire et le merveilleux, ne philosophent pas tant sur leur quotidien : ces protestants ne débattent que du bonheur dans l’ascétisme ou dans l’épicurisme.
Peuple étrange, qui ne craint pas d’interdire le théâtre et raffole en même temps jusqu’à l’excès de la comedy of manners, inventée par Dryden et que Wilde pratiquait encore ; dont le génie littéraire, Shakespeare, mêle avec une audace que Victor Hugo n’eût point osé le grotesque et le sublime, la bouffonnerie et le grandiose ; enfin qui cultive la satire, cette manière de se moquer des mœurs sans jamais remettre en cause l’ordre social, avec une constance admirable…
La période anglo-saxonne
- Vè siècle : Conquête de l’Angleterre (celte et romanisée) par les Angles et les Saxons
- VIè siècle : Introduction du christianisme ; première unification
- Beowulf, Ælfric (Lives of the Saints)
- 1066 : Bataille de Hasings ; Guillaume le Conquérant
Les Celtes peuplaient la Grande-Bretagne avant que les Romains ne l’envahissent en partie, puis les Saxons, les Angles et les Jutes. C’est l’introduction du christianisme, à la fin du sixième siècle, qui commence l’unification du pays. Les rois légendaires, Alfred, Knut, poursuivent cette entreprise, mais l’affaire n’est pas simple : lorsque Guillaume le Conquérant remporte la bataille de Hastings en 1066 et impose le français, on parle dans les îles britanniques pas moins de trois langues, le saxon, l’anglien et le kentien… C’est dans ce magma de Romains, de Celtes, d’Anglo-saxons, de Brigantes, de Pictes et de Scots, de Bretons aussi, que naissent les premières œuvres de la langue anglaise. En prose : The Anglo-Saxon Chronicle, les Lives of the Saints du moine Ælfric. Et en vers : Beowulf, épopée à moitié scandinave, à moitié chrétienne, pur produit des différentes influences culturelles qui se mêlent alors en Grande-Bretagne. On me permettra de comparer l’épopée de Beowulf, écrite en vieil anglais, avec notre Chanson de Roland, écrite en vieux français. La première est en vers allitératifs, la seconde en laisses assonancées ; toutes deux sont des modèles de la littérature épique.
L’époque médiévale
- 1154 – 1189 : Henri II (Plantagenêt)
- 1337 – 1453 : Guerre de Cent Ans
- Chaucer (The Canterbury Tales), Malory (Le Morte d’Arthur)
- 1485 – 1509 : Henri VII (Tudor)
En 1154, Henri II, petit-fils d’Henri Beauclerc et descendant de Guillaume le Conquérant, monte sur le trône : il inaugure la dynastie des Plantagenêts. C’est la lignée de Richard Cœur de Lion et de Jean sans Terre, d’Henri III et d’Édouard Ier, d’Édouard II aussi, marié à Isabelle de France et qui, en revendiquant la Couronne de France, engage la Guerre de Cent ans. En 1486, Henri VII « devient le premier roi de l’Angleterre moderne » (F. Regard). Si la période anglo-saxonne était la gestation de l’Angleterre parlementaire, l’époque médiévale en est l’enfance : Jean sans Terre concède aux barons la « Magna Carta » ; Édouard Ier, qui mène des guerres incessantes, fait du Parlement une véritable institution.
Cette époque est celle où « l’anglais l’emporte définitivement et la littérature connaît un réel épanouissement » (E. Angel-Perez). Comme en France, l’épique cède la place au romance ; à la sauvagerie des batailles on préfère l’honneur de la chevalerie, aux exploits meurtriers, les prouesses de l’amour courtois. La civilisation l’emporte sur la barbarie. Le Morte d’Arthur de T. Malory, premier livre imprimé par Caxton (c’est par l’imprimerie que l’anglais de Londres va progressivement se répandre dans le reste du pays), est publié en 1485 — je signale au lecteur qu’une traduction en français vient de paraître aux éditions de l’Atalante, dans un fort bel ouvrage (lien). Cette époque voit aussi l’apparition de récits allégoriques, avec des personnages comme Vertu ou Tentation, mais aussi l’émergence d’un théâtre religieux (les Mystères et les Miracles). Chaucer, au quatorzième siècle, est « le premier grand maître de l’anglais de Londres » (F. Regard) ; non seulement il introduit le réalisme et la psychologie dans une littérature encore très conventionnelle, mais il concentre en lui les germes de tout ce qui fera plus tard le style anglais : le mélange des genres et des traditions, la bouffonnerie mêlée au tragique (que Voltaire reprochera tant à Shakespeare !), le moralisme anticlérical et cet humour pince-sans-rire…
La période élisabéthaine et jacobéenne
- 1509 – 1547 : Henri VIII roi d’Angleterre (Tudor)
- T. More (Utopia)
- 1558 – 1603 : Elisabeth Ière (Tudor)
- Sidney, Marlowe, Shakespeare, Bacon, Spenser, Ben Jonson
- 1603 – 1625 : Jacques Ier (Stuart)
Sur cette période, je ne me contenterai que de quelques indications historiques. L’histoire s’accélère et le monde s’agrandit. C’est le temps des grandes découvertes, de l’imprimerie, de l’humanisme et du protestantisme, des poussées de l’individualisme et de la raison contre l’ordre social et la superstition. Henri VIII fonde l’Église anglicane ; Elisabeth l’organise ; les « puritains » s’excitent. Le pays, sous la « Virgin Queen », connaît « un impressionnant essor économique » (F. Regard), qui dans le domaine de la littérature contribue à enrichir la langue. Le théâtre surtout se transforme ; les grandes structures circulaires, avec trois rangées de galeries et un parterre à ciel ouvert, remplacent les parvis des Mystères. Le public vient là pour « s’amuser, dit F. Regard, tout en méditant sur le thème favori de la société anglaise, celui du conflit entre intérêt privé et ordre public. » On construit The Theatre en 1576 ; The Rose en 1587 ; The Globe, le théâtre de Shakespeare, en 1598 ; The Fortune en 1600.
De cette époque nous retiendrons Thomas More, auteur d’Utopia : en s’opposant à Henri VIII, en imaginant une société fondée sur la raison, il se fait l’ami des humanistes. Bacon, sorte de Montaigne empiriste (sous toutes réserves), publie des Essays, recueil d’aphorismes et de maximes sur différents thèmes ; Sidney, sorte de Du Bellay hyperbolique (sous toutes réserves !) publie 108 sonnets dans Astrophel and Stella, dont certains figurent encore aujourd’hui parmi les poèmes les plus connus de nos voisins d’outre-Manche (« With how sad steps… ») ; citons également Spenser, « Prince des poètes de son temps », ainsi que l’indique son tombeau à Westminster. Au théâtre, il faut évoquer Marlowe, le premier à développer le fameux blank verse (pentamètre iambique non-rimé)… et bien sûr Shakespeare, « cet immense écrivain-philosophe » (F. Regard), qui « porte à la perfection les tendances qui se dégagent de l’épanouissement théâtral de l’époque élisabéthaine » (E. Angel-Perez).
… Shakespeare fait de la tragédie non plus une question de renversement de fortune, mais une question de caractère individuel, mêlant de manière indissoluble la sphère du privé et celle du public, précipitant la désacralisation des souverains, sapant les fondements mêmes de l’absolutisme. C’est avec Julius Caesar (1599), première tragédie « romaine », que s’exprime d’abord cette veine, qui coïncide avec l’installation de la troupe au théâtre du Globe. Cette thématique, inspirée par la lecture des Vies de Plutarque, est reprise dans Antony and Cleopatra (1606-1607), puis dans Coriolanus (1607-1608). Shakespeare atteint toutefois le sommet de son art avec les quatre chefs-d’œuvre que sont Hamlet (1600), tragédie de la vengeance, Othello (1604), tragédie de la jalousie, King Lear (1605), tragédie de l’aveuglement paternel, et Macbeth (1606), tragédie de l’action politique. Désormais, les conflits sont logés à l’intérieur même de la conscience humaine pour devenir de mortels dilemmes. La fascination que continue d’exercer ce génie à nul autre comparable tient à cette théorisation impitoyable et à cette mise en scène puissante de toute l’absurdité du destin de l’homme, être de raison dévoré par les passions, dans un monde où Dieu ne sauve jamais les innocents.
(F. Regard, Histoire de la littérature anglaise)
Shakespeare, qui fit aussi triompher le sonnet, est le génie de l’Angleterre. Sans trop rentrer dans les détails, j’indiquerai seulement, avec Élisabeth Angel-Perez, que la critique divise habituellement Shakespeare en trois périodes : d’abord, la jeunesse et la maturité (ce sont les pièces historiques et les comédies, où le dramaturge forge son art en suivant les modes) ; puis, l’âge sombre (ce sont les pièces romaines et les pièces « à problème », Hamlet, Othello, King Lear et Macbeth, qui traitent de préoccupations universelles) ; enfin, l’apaisement retrouvé (c’est par exemple Cymbeline et The Tempest, plus optimistes, où le mal est une expérience plutôt qu’un destin).
Charles Ier, Cromwell et la Restauration
- 1625 – 1649 : Charles Ier (Stuart)
- Premières œuvres de Milton
- 1649 : Proclamation du Commonwealth par Cromwell
- Leviathan, Hobbes (Leviathan), Milton (Paradise Lost)
- 1660 – 1685 : Charles II (Stuart) : Restauration
- Dryden et Bunyan
- 1685 – 1688 : Jacques II (Stuart)
- 1689 : Marie II et Guillaume III d’Orange (Glorious Revolution, Bill of Rights)
- Locke (Essay Concerning Human Undestanding)
- 1702 – 1714 : Anne (Stuart)
Quand Jacques Ier monte sur le trône (1603), il passe pour un calviniste aux yeux des anglicans, et pour un anglican aux yeux des puritains ; la tension monte. Son fils Charles Ier, marié à une catholique, règne en monarque absolu, affronte les Écossais, s’oppose au Parlement et aux puritains ; cette fois-ci, c’en est trop : il est décapité le 30 janvier 1649. Cromwell abolit la monarchie et proclame la République (le Commonwealth). Hélas, la république du Lord Protector devient en fait la dictature militaire du puritanisme le plus austère. Charles II rétablit la monarchie, mais l’autorité royale est affaiblie… Jacques II, le frère et successeur de Charles II, n’est pas aimé ; pire : il est catholique ; alors, les Anglais appellent au secours Guillaume d’Orange marié à Marie, la fille du roi Charles. Guillaume marche sur Londres sans verser une goutte de sang : c’est la Glorieuse Révolution, sanctionnée par le Bill of Rights (1689). Cette période est aussi celle des avancées scientifiques (Newton), de l’expansion coloniale (Mayflower), et de l’essor de la gentry citadine contre la pairie des campagnes. Les puritains avaient interdit les théâtres ; ils reviennent sous la Restauration améliorés, et leurs dispositions nouvelles commencent à préfigurer les salles modernes.
L’époque, on l’aura compris, est à la guerre entre les républicains puritains et les royalistes. En poésie, les poètes métaphysiques, à l’écriture quelque peu précieuse (Donne, Herbert, Marvell), s’opposent aux poètes cavaliers du baroque, libertins, partisans de Charles Ier et ennemis des Puritains (Carew, Lovelace, Suckling). Milton, au dix-septième siècle ce que Shakespeare est au seizième, puritain militant pour le divorce et la liberté de la presse, incarne parfaitement le trouble de ces années sanglantes. Dans L’Allegro et Il penseroso, il décrit d’abord le bonheur de l’épicurisme puis la joie de l’ascétisme. Son puritanisme l’emporte finalement : Paradise Lost, réécriture épique de l’ouverture de l’Ancien Testament (de la création du monde à l’expulsion d’Adam et Ève du Paradis), est aussi une critique du roi Charles.
Si les apparences semblent présenter ce poème épique comme d’inspiration purement religieuse, la réalité est qu’au XVIIè siècle, le religieux n’est jamais très loin du politique. À travers la chute de l’homme, la situation politico-religieuse tout entière est analysée, et en particulier les moments qui ont précédé l’instauration de la République puritaine — le Commonwealth de Cromwell —, véritable structure de châtiment visant à sanctionner les abus et la débauche propres à la monarchie de Charles Ier. Paradise Lost traite essentiellement du pouvoir […]. Manifestant une conscience aiguë des problématiques de son temps, ce poème s’inscrit dans l’histoire particulière du début du XVIIè siècle par les thèmes abordés et leurs parallèles dans la vie politique, ainsi que par la forme vivante que Milton lui donne : Paradise Lost est non seulement une épopée (qui décrit des faits appartenant au passé), c’est aussi un poème dramatique incroyablement présent.
(Élisabeth Angel-Perez, Histoire de la littérature anglaise)
Du côté des philosophes, il faut citer Hobbes, qui dans Le Leviathan développe une espèce de théorie du contrat social légitimant la monarchie absolue : l’homme, loup pour l’homme, aspire à la sécurité plutôt qu’à la liberté ; pour garantir la première, il transfère la seconde au monarque ; ainsi c’est d’une convention collective, plutôt que d’un droit divin, que provient le régime monarchique. Hobbes appartient au courant rationaliste. John Locke, à la même époque, défend la tolérance et fonde l’empirisme anglais (Essay concerning human understanding).
Enfin, je ne peux m’arrêter sans évoquer Bunyan et Dryden. Le premier est l’auteur du célèbre Pilgrim’s progress, récit qui relate le voyage de Chrétien du péché au Paradis, en passant par the slough of despond, the valley of humiliation, the valley of the shadow of death, et bien sûr the vanity fair, lieu qui inspirera Thackeray quelques années plus tard…
… s’adressant aux humbles pour leur proposer un modèle de vie réussie, parvenant à incarner des enjeux théologiques dans un contexte réaliste, célébrant l’union de la langue biblique et du langage idiomatique, tout en offrant à la littérature anglaise l’un de ses mythes les plus puissants, celui de la vie comme voyage initiatique, The Pilgrim’s Progress préfigure la naissance du roman.
(F. Regard, Histoire de la littérature anglaise)
Si l’œuvre de Bunyan rappelle par certains traits la doctrine calviniste, voire puritaine, Dryden de son côté représente la « veine satirique » qui « l’emporte dans cette seconde partie du XVIIè siècle » contre « l’hypocrisie et les bigots, en un mot, les Puritains » (E. Angel-Perez). Dryden, partisan de Cromwell puis de Charles II (sans surprise, Poet Laureate au terme de sa carrière), anglican avant d’être catholique, épique mais aussi satirique, se moque des politiques et des écrivains dans quelques ouvrages dont les titres ne diront pas grand-chose aux lecteurs français. Dryden est également l’auteur de plusieurs tragédies remarquées, parmi lesquelles All for Love (1677), sur Antoine et Cléopâtre, dont je regrette infiniment qu’elle n’existe pas traduite en notre langue… Surtout, son Marriage à la Mode lance la mode, justement, des comédies de mœurs (comedy of manners) dont les Anglais raffoleront jusqu’à Oscar Wilde. Notons que le théâtre de la Restauration devient un peu plus semblable à ce qu’est le théâtre de nos jours qu’à ce qu’il était sous Shakespeare ; et que la comédie qui triomphe alors, tout en quiproquos et comique de situation, ressemble parfois étrangement au vaudeville français (lire The Country Wife, de Wycherley, qui contient quelques scène d’anthologie !).
Le dix-huitième siècle
- 1702 – 1714 : Anne (Stuart)
- 1714 – 1727 : Georges Ier (Hanovre)
- Defoe, (Robinson Crusoe), Swift (Gulliver’s Travels)
- 1727 – 1760 : Georges II (Hanovre)
- Pope, Hume, Richardson, Fielding, Samuel Johnson
- 1760 – 1820 : Georges III (Hanovre)
- Sterne, Walpole, Sheridan, Burns, Blake, Radcliffe, Burke
Après les déboires des périodes précédentes, les règnes d’Anne, de Georges I, Georges II et Georges III paraissent plutôt paisibles. C’est l’ « Augustan Age », où triomphe le néoclassicisme. Le spectre de la guerre civile s’éloigne. En 1746, les Jacobites, derniers partisans de Jacques II, sont défaits à la bataille de Culloden. À Londres, les Tories favorables au Roi, plutôt conservateurs, s’opposent pacifiquement aux Whigs favorables au Parlement (plutôt libéraux, donc). Le pays, « fondé sur l’éthique protestante du travail et de la rigueur morale », est « pacifié, puissant et prospère » (F. Regard). James Cook, Vancouver découvrent de nouvelles terres. On développe les routes, le commerce et la presse. L’île tout entière, par une industrialisation précoce liée au coton d’Amérique, connaît une croissance économique spectaculaire. La révolution américaine, le début catastrophique du règne de Georges III, ne sont que des ombres passagères au tableau ; contre Napoléon, le Royaume-Uni (Grande-Bretagne et Irlande depuis l’Acte d’Union de 1801) domine les mers ; en 1815, après Waterloo, il devient le maître du monde. Sur le plan littéraire, alors qu’en France on sépare habituellement le classicisme des Lumières, au dix-huitième le classicisme anglais, annoncé par Dryden, se marie parfaitement avec l’Enlightenment ; de même, alors qu’en France le siècle des Lumières est resté comme le siècle des philosophes, et le dix-neuvième comme celui des romanciers, en Angleterre, le dix-huitième coïncide avec la promotion du roman : « forme esthétique, note F. Regard, la plus emblématique du nouvel esprit bourgeois, frondeur et sûr de lui » ; traduction de la victoire, note E. Angel-Perez (et c’est pour nous paradoxal !), de la raison sur l’imagination…
Je ne m’attarderai pas sur la philosophie de Hume, ami de Rousseau, qui poursuit l’empirisme de Locke. Pour ce philosophe, il ne faut se fier qu’à nos sens, pas à la raison ; ainsi, dans le champ de l’expérience sensible, il faut distinguer les impressions (brûlure) et les idées (souvenir de la brûlure) et se méfier des associations, des habitudes et des croyances, qu’on finit par confondre avec des lois de causalité. Hume, agnostique, ne pouvait affirmer que Dieu existe parce qu’il n’avait jamais fait l’expérience de Dieu : son scepticisme était radical. Comme Hume continue l’empirisme de Locke, Pope continue le classicisme de Dryden, traduisant les auteurs grecs et latins, pensant sur l’homme (Essay on Man), excellant dans la satire (The Rape of the Lock). Jonathan Swift, autre maître de la satire, écrit Meditation upon a Broomstick, où il « compare très astucieusement, dans un style du plus pur classicisme (concis, efficace, mesuré), l’homme à un balai » : ce doit être l’humour anglais. On retiendra surtout Swift pour les Gulliver’s Travels ; je comparais Beowulf à La Chanson de Roland : de même, comment ne pas penser à Pantagruel et Gargantua, en lisant le récit des voyages de Gulliver ?… Il y a quelque chose d’évidemment rabelaisien (quoique nettement plus pessimiste !) dans cette mise en scène de géants et de créatures fantaisistes, destinés à nous faire réfléchir sur l’homme.
Addison et Steele, d’abord dramaturges, connaissent finalement le succès par leurs journaux : The Tatler et The Spectator. Daniel Defoe, un autre journaliste, est resté quant à lui dans l’histoire pour Robinson Crusoe — dont je ne rappelle pas l’intrigue —, « acte de naissance du roman moderne » selon la formule de Frédéric Regard.
L’éthique protestante, fondée sur le labeur et sur le succès économique, s’est trouvée un héros, dans le même temps que le roman, expression de l’inadéquation du sujet individuel au monde, et forme générique de toutes les libertés, s’est donné une figure archétypale. Le sous-genre dit de la « robinsonnade » témoignera de la puissance originelle de cette formule.
(F. Regard, Histoire de la littérature anglaise)
De l’épanouissement du roman qui suit l’œuvre de Defoe, nous retiendrons Samuel Richardson, dont le Clarissa Harlowe fait irrésistiblement penser aux Liaisons dangereuses de Laclos ; Henry Fielding pour Joseph Andrews, « épopée comique en prose » et l’un des premiers romans anglais à la troisième personne ; Tobias Smollett, auteur de romans picaresques ; Laurence Sterne enfin, parce que son Tristram Shandy, un work in progress fiction énorme de digressions — dont l’action est la création littéraire elle-même —, à peu près inconnu en France, est pourtant célébrissime de l’autre côté de la Manche. Au théâtre, on soulignera l’importance de John Gay et de Sheridan ; le premier porte la satire sur les planches ; le second remet au goût du jour la comedy of manners. Pope, Swift et Gay, avec d’autres, faisaient partie du même club anti-Whigs.
Comme en France, l’Angleterre de la fin du dix-huitième siècle voit l’apparition de pré-romantiques : c’est d’abord James Macpherson, auteur dans les années 1760 d’une fausse traduction des récits d’Ossian, un poète imaginaire de l’ancienne Écosse (l’engouement est énorme : Ossian fascinait même Napoléon) ; ce sont aussi les gothiques qui se complaisent dans l’esthétique de l’horreur et de l’irrationnel des châteaux hantés — Walpole (The Castle of Otranto), Ann Radcliffe (The Mysteries of Udolpho). Robert Burns, paysan-poète à la culture populaire que T. Carlyle range parmi ses Héros, d’expression quasi vernaculaire, préfigure « la poésie gouvernée par l’imaginaire et la rêverie » par sa « simplicité troublante », et son « affection sans pareille pour la nature qui l’entoure » (E. Angel-Perez) : il a écrit le très célèbre « Auld Lang Syne » ! Mais le plus grand poète pré-romantique anglais, n’en déplaise à Carlyle, demeure évidemment William Blake.
En 1794, Blake ajoute aux « Songs of Innocence » son pendant contradictoire, les « Songs of Experience », pour former Songs of Innocence and Experience, œuvre d’un artiste visionnaire complet, dont les talents de dessinateur, de graveur et de poète sont désormais indissociables. Cherchant l’inspiration dans les comptines pour enfants ou dans les ballades populaires, transcendées par un sens du concret visuel et par le déploiement d’une pensée profonde fondée sur la dialectique des forces contraires, les « Songs of Experience » contiennent des poèmes très célèbres comme « Tyger ! Tyger ! burning bright », « O Rose thou art sick » ou encore « London ». C’est de cette époque que date sa première pièce maîtresse en prose, The Marriage of Heaven and Hell (1790-1793), ensemble d’aphorismes paradoxaux célébrant l’énergie vitale.
(F. Regard, Histoire de la littérature anglaise)
Je ne peux conclure ce dix-huitième siècle sans évoquer Samuel Johnson, résolument classique, auteur de satires, de biographies et de contes philosophiques ; et surtout deux hommes qu’il recevait dans son salon : Edward Gibbon, auteur d’une monumentale histoire de la chute de Rome ; et bien sûr Edmund Burke, fondateur du libéralisme conservateur.
Le romantisme
- 1760 : Georges III (Hanovre)
- Walter Scott, Byron, Mary Shelley, Keats
- 1820 – 1830 : Georges IV (Hanovre)
- 1830 – 1837 : Guillaume IV (Hanovre)
- Carlyle
À partir de la fin du dix-huitième siècle, la raison de l’Âge d’Auguste s’efface peu à peu au profit de la poésie et de l’imaginaire. On exalte la liberté, la nature et le moi, dans un lyrisme mystique où l’interdit côtoie la démesure. Le rationalisme a décrédibilisé la figure du Prêtre ; le Poète, qui croit communiquer avec le monde supérieur par le truchement de l’imagination, devient le nouveau guide spirituel de l’homme (voir à ce propos la thèse de P. Bénichou) : c’est l’avènement du romantisme. Le romantisme français a d’abord été très conservateur (Chateaubriand, Hugo des Odes et ballades) ; le romantisme anglais, au contraire, embrasse immédiatement des tendances politiques plutôt sociales, pour ne pas dire socialistes : Jérémy Bentham théorise l’utilitarisme, l’idéal du bonheur démocratique ; William Godwin, plus extrême, finit dans l’anarchisme et l’athéisme.
Je parlais du romantisme français : on a l’habitude de considérer les Méditations poétiques, de Lamartine (1820), comme son acte de naissance ; le romantisme anglais naît quant à lui officiellement un peu plus tôt, en 1798, avec les Lyrical Ballads de Wordsworth et Coleridge. La préface, manifeste du mouvement, invite le poète à s’exprimer sur ses sentiments propres et sur la beauté du monde, dans un langage simple universellement compréhensible. Wordsworth et Coleridge, avec Southey, ont été les « Lake Poets », les premiers romantiques. Certains poèmes de Coleridge, « poète de l’imagination », présentent à la fois des accents nervaliens et des tons baudelairiens (rien que ça) — pour reprendre les mots d’E. Angel-Perez. Celui que vous connaissez peut-être est le Dit du vieux marin, qui raconte l’histoire d’un marin maudit après avoir tué un albatros porte-bonheur. Aux « Lakist » succède une seconde génération de poètes non moins brillante : Byron, Shelley et Keats. Lord Byron est sans conteste l’un des rares poètes anglais largement connus des lecteurs français, parce qu’il a inspiré d’innombrables de nos écrivains. Lord élevé dans la nature, étudiant débauché, poète et satiriste (un pur Anglais, en somme !), exilé, Byron, après avoir fait le tour de l’Europe et soutenu les combats des peuples, devient à sa mort, en Grèce, — presque au front —, « l’emblème du romantisme anglais en Europe » (E. Angel-Perez). Son Manfred est encore aujourd’hui l’archétype du romantique atteint du mal du siècle, le Faust anglais, l’Octave britannique.
La figure légendaire de Byron ravive la flamme révolutionnaire, brouille la frontière entre vie et littérature, et incarne pour la postérité le héros romantique par excellence.
(F. Regard, Histoire de la littérature anglaise)
Je ne m’étends pas sur Keats et Shelley, amis de Byron — deux grands poètes qui trouvaient leur inspiration dans les sujets mythologiques plutôt que médiévaux.
On connaît l’importance, en France, du théâtre à l’époque romantique (d’Hernani jusqu’à Cyrano, en passant par Vigny, Dumas, Musset et j’en passe) ; en Angleterre, le roman éclipse le drame. À ce propos, deux géants, non seulement de la littérature anglaise mais de la littérature européenne, s’imposent comme des références : Walter Scott et Jane Austen. Le premier, « grand inventeur du roman historique » (F. Regard), Dumas d’Angleterre, est bien sûr l’auteur de Waverley, The Talisman, Ivanhoe. La seconde, « romancière préférée des Anglais » (F. Regard), ressemble à une Balzac d’outre-Manche, mais cantonnée aux maisonnées de la petite bourgeoisie : c’est dire qu’elle est réaliste et psychologue, et sans grandes ambitions. Avec Sense and Sensibility, Pride and Prejudice, Mansfield Park, Emma, Austen s’inscrit « dans la tradition de la comedy of manners« , mais « renouvelle le genre en introduisant de subtiles analyses psychologiques, que seule la forme romanesque autorise » (F. Regard).
Je cite au passage Mary Shelley pour Frankenstein, et les essayistes « préoccupés par l’évolution de la société » (E. Angel-Perez) : Godwin, dont sa croyance dans un perfectibilisme entraînant la fin du désir sexuel a conduit Malthus à lui opposer son idée de contrôle des naissances, l’homme étant pour lui fondamentalement affamé et sexuel, mais aussi Lamb, Hazlitt et Thomas De Quincey, buveur et penseur d’opium — cité par Apollinaire dans « Cors de chasse »…
L’époque victorienne
- 1837 – 1901 : Victoria (Hanovre)
- Darwin, Ruskin, sœurs Brontë, Thackeray, Tennyson, Dickens, Carroll, Eliot, Stevenson, Wilde, Conrad, Kipling
Le Royaume-Uni, après 1815 et Waterloo, connaît une seconde révolution industrielle. L’empire se couvre de chemins de fer : c’est le Railway Age. L’île d’Albion, prise d’une véritable frénésie du rail, disparaît sous la vapeur des locomotives. Le libéralisme économique, couplé à la morale protestante — la respectability —, conduit l’Angleterre on the road to perfection (John Stuart Mill) et force l’admiration des peuples. La reine Victoria, entre 1837 et 1901, « restaure le prestige monarchique » (F. Regard), libéralise la politique (Catholic Relief Act, Reform Bill), et adoucit quelque peu la condition des prolétaires par des lois sociales qui s’échelonnent tout au long du siècle. Mais l’industrialisation entraîne aussi la ruine des fermiers, la surpopulations dans les villes, la destruction des vieux paysages par l’établissement de grandes cités industrielles. Comme en France, en Angleterre, l’industrie est favorable au roman : l’écrivain se professionnalise ; l’éditeur gouverne le marché du livre.
John Stuart Mill, les chartistes (dont la philosophie se rapproche du socialisme), et d’autres auteurs s’élèvent contre l’esprit du temps. Carlyle notamment dénonce le matérialisme capitaliste. Sartor Resartus, Past and Present intéresseront plutôt un public anglais ; mais je recommande chaleureusement Heroes, recueil d’une série de conférences données devant le tout-Londres sur quelques personnalités considérées comme héroïques, ainsi que The French Revolution — qui inspira Dickens pour son Tale of Two Cities. Puisque je traite de philosophie, je suis obligé de citer Charles Darwin dont on nul n’ignore l’importance de l’Origine of species, Ruskin aussi, ardent défenseur de Turner, de l’art gothique et des préraphaélites, et de l’art comme refuge contre le monde marchand.
Tennyson et Browning incarnent la poésie victorienne ; vous connaissez peut-être le premier pour les Idylls of the King, magnifiquement illustrées par G. Doré. « La poésie victorienne, souligne F. Regard, souffre d’une mauvaise image, alors que le conservatisme dont elle fait souvent preuve, il est vrai, peut se conjuguer avec humour, angoisse et même audace. » Je ne m’arrête pas longtemps sur la poésie dite sensualiste, Dante Rossetti et les préraphaélites ; juste pour évoquer l’étrange William Morris (socialiste utopique, designer, Anglo-Saxe homérique), Swinburne (scandaleux comme Baudelaire, et dont la sensualité confine au sexuel), et Hopkins (au « style heurté », qui « jette déjà un pont vers le modernisme », selon F. Regard). Plus que la poésie, l’économie et la philosophie, c’est le roman qui trouve son plein épanouissement à l’époque victorienne. Ann (Agnes Grey), Emily (Wuthering Heights) et Charlotte Brontë (Jane Eyre) se distinguent dans un genre plutôt romantique et marquent profondément l’histoire littéraire de ce siècle. Mais ce n’est rien encore à côté de Charles Dickens, le Victor Hugo de l’Angleterre, l’un des trois plus grands romanciers d’Europe pour Stefan Zweig, qui lui a consacré un essai où il le place au même rang que Balzac et Dostoïevski. Avec Oliver Twist, David Copperfield, A Tale of Two Cities, Great Expectations et j’en passe, Dickens aura été l’incarnation du type anglais, satiriste et bourgeois, mêlant humour et mélodrame, caricature et réalisme.
Dickens n’est pas seulement le génial inventeur de personnages inoubliables […], le révolutionnaire du marché de la littérature (qui publie chaque année des contes de Noël, les fameux Christmas books, le plus célèbre étant A Christmas Carol, 1843), ou le peintre implacable des scandales de la société victorienne […]. Les thèmes que cet immense romancier introduit en littérature (l’enfant perdu comme personnage central) et les formes qu’il invente au fur et à mesure de sa carrière (fusion du réel et de l’imaginaire dans David Copperfield ; déformation caricaturale des personnages en humors, héritiers grotesques de Ben Jonhson ; roman à deux voix dans Bleak House ; intrigues concurrentes dans Out Mutual Friend) modifient durablement la conception de l’écriture romanesque. Usant avec brio de l’ironie et de la satire, Dickens anime le roman de petites gens (criminels, pickpockets, prostituées, enfants des rues) chez qui le bien l’emporte en fin de compte, démontrant que le peuple, jeté à la rue par les circonstances, reste le dépositaire de vertus non frelatées.
(F. Regard, Histoire de la littérature anglaise)
En France, Dickens passe par erreur pour un socialiste : que nenni. Encore en cela incarnation du type anglais, il est autant conservateur qu’il est radical. Extrait-il un enfant de la rue ? — c’est pour l’asseoir dans le fauteuil d’un douillet cottage, avec sa bonne femme et en pantoufles. Le lecteur français aimerait mieux, je crois, Thackeray que Dickens, et c’est bien dommage que le premier soit resté moins célèbre que le second. L’auteur de Barry Lyndon — porté à l’écran par Kubrick dans un film légendaire —, tout en ne se départissant jamais de cette « ironie désabusée » propre à l’Anglais, développe dans sa fiction une philosophie moraliste digne à certains moments d’un La Rochefoucauld. Dans Vanity Fair, que je ne saurais trop recommander, Thackeray décrit l’homme d’une manière exquise, et surtout, preuve de grande intelligence, « le monde tel qu’il est et non tel qu’il pourrait se rêver » (F. Regard).
Mea culpa, je connais mal George Eliot, alors pourtant que ses romans ont marqué l’ère de la reine Victoria ; cette espèce de George Sand anglaise, appréciant tout particulièrement le cadre de l’Albion rurale, a produit quelques romans psychologiques à multiples intrigues fort remarqués, dont Middlemarch — préfacé par Virginia Woolf. Je signale aussi Trollope, descripteur des intrigues de la province britannique, et Gissing, plus pessimiste, et qui s’intéresse aux classes les plus pauvres.
Il y a un côté décadentiste dans le roman fin-de-siècle anglais. « En brisant l’image de l’artiste moralisateur, explique très bien F. Regard, et en la remplaçant progressivement par la figure de l’artiste en exil, le roman de la fin du siècle prépare la mort d’une écriture centrée sur la personne de l’auteur comme autorité morale ». À la peur du métissage et de la dégénérescence, on oppose une sexualité à faire tomber les Puritains en syncope ; les territoires inconnus ne fascinent plus, ils terrifient ; Jack l’Éventreur rôde parmi les rues de Londres… Esprit anglais oblige, cela n’empêche pas Oscar Wilde, à propos de qui André Gide raconte des anecdotes horribles dans Si le grain ne meurt, de divertir l’Angleterre. Ses comédies à l’humour délicieux enchantent les spectateurs, Lady Windermere’s Fan, A Woman of No Importance, An Ideal Husband et surtout The Importance of Being Earnest. Avec Salomé, écrite en français et inspirée de Flaubert, il montre qu’il peut aussi exceller dans un genre plus sombre. On connaît la passion de Wilde pour Lord Douglas, et sa chute brutale ; condamné pour homosexualité, il est incarcéré dans des conditions particulièrement difficiles, crie son désespoir (De Profundis), et meurt en exil à Paris. Sa vie de dandy poignardé par le puritanisme est bien représentative de l’esprit anglais.
L’arme de prédilection de Wilde reste le wit, le dialogue brillant et épigrammatique, qui rappelle fortement la comedy of manners, mais que le dramaturge met au service d’une ironie corrosive contre les idées préconçues.
(F. Regard, Histoire de la littérature anglaise)
George Bernard Shaw, plus sérieux que Wilde, invite la politique sur les planches ; cet anticonformiste s’attaque notamment aux milieux bourgeois dans une pièce considérée comme son chefs-d’œuvre, Heartbreak. Butler, de son côté, s’en prend au christianisme autant qu’au darwinisme et « constitue, pour F. Regard, une sorte d’adieu à l’ère victorienne ».
Je ne peux achever ce rapide tour du siècle littéraire sans évoquer Meredith, qui au nom de l’hypocrisie charge l’amour conjugal avant de s’essayer à la représentation de la vie intérieure dans des œuvres de plus en plus complexe, et T. Hardy, dont le Tess of the D’Urberville a été adapté au cinéma par Roman Polanski ; mais aussi et surtout, cinq cinq écrivains dont la renommée a largement dépassé les frontières de l’Angleterre : Robert Louis Stevenson, Rudyard Kipling, Joseph Conrad, Lewis Carroll et Arthur Conan Doyle.
Conan Doyle, avec Sherlock Holmes, poursuit brillamment la tradition du roman policier initiée en Grande-Bretagne par Wilkie Collins. On pourrait disserter pendant des heures sur les structures des récits de Stevenson, qui dans Treasure Island, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, The Master of Ballantrae, se révèle comme un génie de la narration. Kipling, né à Bombay, premier Britannique à recevoir le prix Nobel de littérature, archétype so british de l’écrivain colonialiste, est l’auteur de The Jungle Book, et surtout Kim, son roman le plus abouti. « Avec Kipling, note utilement E. Angel-Perez, le roman victorien confirme une tendance présente dans l’ensemble de la période : la littérature centrée sur l’enfance comme personnage ». On connaît Lewis Carroll, maître du nonsense, pour Alice’s Adventures in Wonderland et Through the Looking-Glass ; là encore, c’est l’enfance qui est au cœur du récit, et même de l’entreprise narrative (James Barrie publie Peter Pan en 1904).
Joseph Conrad, écrivain du tournant du vingtième, nous servira de transition parfaite pour la période suivante. Selon E. Angel-Perez, il appartient plus au vingtième siècle qu’au dix-neuvième, et son œuvre est « essentielle » pour comprendre Joyce, Woolf et Lawrence. Autant que Stevenson, Conrad surprend par ses structures narratives intra-homo et intra-hétéro-diégétiques (pardon pour ces barbarismes !) tout en analepses ; E. Angel-Perez parle de structure narrative « gigogne » ou en abyme (récit dans le récit). De cet immense écrivain au récit particulièrement poétique, je recommande Heart of Darkness (adapté au cinéma par F. Ford Coppola dans Apocalypse Now) et Lord Jim, outre l’ensemble de ses nouvelles (les éditions Gallimard, en 2003, coll. Quarto, ont fait des nouvelles de Conrad un très bel ouvrage).
La première moitié du vingtième siècle
- 1901 – 1910 : Edward VII (Hanovre-Windsor)
- Conrad, Shaw, H.G. Wells
- 1910 – 1935 : Georges V (Hanovre-Windsor)
- Lawrence, Joyce, T.S. Eliot, Woolf, Huxley
- 1936 : Edward VIII (Hanovre-Windsor)
- 1936 – 1952 : Georges VI (Hanovre-Windsor)
- Orwell
Le règne de Victoria a quelque peu gâté le pays, qui après sa mort vit de ses rentes et ne se développe pas comme l’Allemagne ou les États-Unis. C’est la fin de l’âge d’or capitaliste. Les socialistes, les syndicalistes fondent le Labour Party ; les manifestations ouvrières se multiplient ; l’Irlande réclame son indépendance. En 1914 éclate la Première Guerre mondiale, qui choque l’Angleterre profondément, comme du reste l’Europe et le monde. L’effort de guerre, considérable, entraîne une nouvelle crise économique ; la « Great Depression » de 1929 n’arrange rien…
En littérature, deux conceptions s’opposent : les vieilles conventions qui s’adaptent au progrès technique, contre l’écrivain qui veut faire table rase du passé et laisser son génie s’exprimer en dehors de toute règle et de toute tradition. Autrement dit, la croyance en des règles, la littérature comme une initiation (la « veine traditionaliste », E. Angel-Perez), contre la croyance en un génie innée de l’art venu du sentiment : c’est peu ou prou les débats littéraires que connaît la France également (je pense ici au surréalisme et à son abhorration des conventions : « La marquise sortit à cinq heures »). Avec le modernisme, l’heure est à la littérature expérimentale, à l’abandon des formes, à la grande destruction des codes. « C’est le triomphe de la parodie et du simulacre, écrit F. Regard, du collage et du fragment, la mort de la narration plane du récit traditionnel. Le modernisme reflète ainsi une nouvelle conception de la subjectivité : le travail d’écriture ne se conçoit plus comme le témoignage d’un savoir, le prolongement d’une autorité, l’outil d’une conscience morale ; c’est l’expression d’une nouvelle subjectivité éclatée, n’existant que dans et par le texte. » Mais le triple effet de la guerre, de la crise économique et de l’impasse dans laquelle les modernistes ont jeté la littérature, entraîne aussi la montée d’une nouvelle génération d’écrivains qui proclament un retour à l’engagement politique de l’auteur. Alors, écrit encore Frédéric Regard, « les artistes cherchent une voie, cherchent leur propre voix, digérant la révolution marxiste comme la révolution psychanalytique, le surréalisme français comme le reportage de guerre, la déferlante moderniste comme la puissante machine réaliste de l’ère victorienne. » Élisabeth Angel-Perez, plus synthétique, parle d’une littérature « hétérogène » née « des deux guerres mondiales, de la désintégration de l’Empire britannique (on assiste du même coup à la naissance d’une littérature du Commonwealth en langue anglaise), de la Révolution russe et de la crise de 1929. »
La littérature devient pléthorique à partir du vingtième siècle ; je ne m’en tiendrai donc plus qu’aux noms les plus connus (pour nous autres Français, du moins), en reprenant ici la classification opérée par E. Angel-Perez.
Le roman, chez les traditionalistes, trouve à s’épanouir dans le domaine de l’imaginaire et de la science-fiction. H.G. Wells, « avocat infatigable de la justice sociale », publie avec The Time Machine le premier roman d’anticipation ; suivront The Island of Dr Moreau, The War of the Worlds (adapté au cinéma à de multiples reprises, par des réalisateurs aussi fameux que Spielberg), et The Shape of Things to Come. Aldous Huxley (Brave New World), George Orwell (1984) excellent dans le genre dystopique. Écrivains politiques, la plume au service du libéralisme, ils pourfendent le totalitarisme. Orwell, dans l’inoubliable Animal Farm, parodie avec génie « la révolution qui se transforme en dictature » (E. Angel-Perez). J.R.R. Tolkien, avec The Lord of the Rings, développe de son côté le registre de la fantasy pour critiquer le monde industriel.
On ne s’étonnera guère d’apprendre que Forster admirait Proust ; ses romans sur la grande bourgeoisie de l’Angleterre post-victorienne rappellent par certains côtés, quoique avec des thématiques propres à sa nation (le fantasme italien) les sept tomes de La Recherche. L’un de ses chefs-d’œuvre, A Room with a View, a fait l’objet d’une extraordinaire adaptation cinématographique par James Ivory, avec Helena Bonham Carter, Maggie Smith, Daniel Day-Lewis, Judi Dench et Rupert Graves — entre autres ! Quant à Graham Greene, qui a été très populaire, c’est lui-même qui a porté ses romans au cinéma, notamment The Third Man — film iconique avec Orson Welles et Joseph Cotten.
Aux traditionalistes, disais-je, on oppose dans l’histoire de la littérature anglaise les modernistes : ce sont, pour ne citer que trois des plus grands, James Joyce, Virginia Woolf et D.H. Lawrence. L’écrivain dublinois James Joyce éclate la tradition du roman dans Ulysses, mêlant les styles, déplaçant les lois du genre, développant la technique du stream of consciousness — qui n’est pas une écriture automatique, mais plutôt une transcription des pensées des personnages comme elles viennent (lire Les Lauriers sont coupés, d’Édouard Dujardin : c’est le livre qui inspira Joyce). Finnegans Wake, intraduisible, est illisible : ici Joyce, bien digne d’un surréaliste français, a désintégré le roman ; ne reste plus que la langue, sur laquelle il joue à la faire souffrir, et à faire souffrir le lecteur… On rattache d’habitude plutôt la technique du stream of consciousness à Virginia Woolf, membre très influente du Bloomsbury Group (un petit cercle d’amis qui comptait Keynes parmi ses membres, Forster et Roger Fry). Dans Mrs Dalloway, la fille de Leslie Stephen utilise les pensées de son personnage pour dilater le temps, et retracer l’ensemble de sa vie en une seule journée. Un peu comme Joyce, Woolf, qui abandonne les notions conventionnelles de story et de plot, privilégie les « moments of being ». L’auteur de To the Lighthouse et The Waves porte son esthétique si haut qu’elle finit par diluer ses protagonistes dans leurs propres sensations.
En d’autres termes, l’extérieur est intégré à l’intériorité du personnage et n’a d’intérêt que parce qu’il est appréhendé par un personnage dont la pensée, sans cesse en mouvement, se dévie en fonction de l’impact de cet extérieur. Le mouvement incessant, fort et continu comme un tourbillon (vortex), notion-clé de la technique de Virginia Woolf, st précisément ce qui a inspiré au peintre-romancier Wyndham Lewis (Tarr, 1918), le mouvement dit « vorticiste » tant admiré par T.S. Eliot.
(Élisabeth Angel-Perez, Histoire de la littérature anglaise)
D.H. Lawrence, issu de la classe ouvrière contrairement à Woolf, auteur de Sons and Lovers, The Rainbow, Women in love, The Plumed Serpent, Lady Chatterley’s Lover — pour ne citer que les plus connus —, voit dans la sexualité un chemin pour renouer avec le lien vital de la nature — sectionné par la révolution industrielle.
Quant au théâtre, nous retiendrons trois noms, Synge, Eliot et Yeats. Comme Burns était le poète des petites gens d’Écosse, Synge se fait le dramaturge des campagnards d’Irlande ; metteur en scène de « l’errance et de la dépossession » (F. Regard) avec Riders to the sea, The Playboy of the Western World, il « annonce Beckett » (E. Angel-Perez) dans The Well of the Saints. T.S. Eliot (prix Nobel 1948), poète de l’entre-deux-guerres, s’inspire de sa conversion à l’anglicanisme pour écrire Murder in the Cathedral, a pour sujet le meurtre historique de l’archevêque Thomas Becket par le roi Henri II. Par la suite, on retrouve « la nécessité du martyre pour accéder à la sainteté » (E. Angel-Perez) dans presque toutes les pièces du dramaturge, pièces écrites en vers de plus en plus souples (jusqu’à l’excès), comportant parfois des chœurs comme dans l’antiquité grecque, alliant après la guerre symbolisme et naturalisme. William Butler Yeats, prix Nobel de littérature en 1923, très connu pour sa poésie, fonde aussi l’Irish National Theatre de Dublin, où il fait jouer ses pièces empreintes de mythologie celtique (The Death of Cuchulain). La découverte du Nô, théâtre traditionnel japonais, l’amène à changer sa conception de la mise en scène : il écrit alors des pièces avec des danseurs (Four Plays for Dancers), et troque le réalisme pour des décors plus abstraits, d’un expressionnisme épuré.
En poésie, un dialogue s’instaure entre les « géorgiens » (Walter De La Mare, John Masefield, Robert Graves), qui reviennent au lyrisme pastoral, et les « War Poets ». Ces derniers — Rupert Brooke, Siegfried Sassoon, Isaac Rosenberg, Wilfred Owen —, s’éloignant du cadre bucolique des géorgiens, évoquent dans des poésies poignantes les atrocités de la guerre. T.S. Eliot, inspiré à la fois par les symbolistes français et les imagistes anglais, par son rejet du subjectivisme des romantiques, par ses jeux sur les rythmes, rompt avec la poésie victorienne. Cet élève de Bergson, ami d’Ezra Pound (moderniste révolutionnaire — et fasciste), publie avant de se consacrer au théâtre Poems, The Waste Land, Four Quartets, qui comptent parmi les poèmes les plus connus de la littérature britannique.
Cette figure centrale du modernisme, qui énonce sans la moindre ambiguïté que la poésie doit se défaire de l’émotion et de la personnalité au profit de ce qu’il nomme des objective correlatives (The Sacred Wood), cherche principalement à réconcilier la culture du passé et la réalité du présent (par exemple, les bombardements massifs de Londres dans les Quartets). Ainsi le poème doit-il selon lui remédier à une désastreuse « dissociation of sensibility », en réunifiant la pensée et la sensation, thought et feeling, à l’instar de la poésie métaphysique […].
(F. Regard, Histoire de la littérature anglaise)
La seconde moitié du vingtième siècle
- 1952 – 2022 : Elisabeth II (Windsor)
- Beckett, Goldin, Osborne, Burgess, Murdoch, Larkin, Swift,
Le Royaume-Uni sort vainqueur mais ruiné de la Seconde Guerre mondiale. Dans un contexte de guerre froide, il se tourne vers les États-Unis, reprend son économie en main et se désengage pacifiquement de ses colonies. Le temps n’est pas toujours au beau fixe : à l’insurrection irlandaise de 1968 s’ajoutent les chocs pétroliers et les grèves des mineurs ; puis, le pays doit faire face lui aussi à la montée des mouvements de la déconstruction, ainsi qu’à l’immigration massive. Cependant Margaret Thatcher (conservatrice libérale) et Tony Blair (social-libéral) marquent de leur empreinte la politique britannique, et permettent à l’Angleterre de tirer son épingle du jeu mondial. La littérature de ce temps, éprouvée comme au lendemain de la Première Guerre mondiale par les abominations de la Seconde, peine à trouver ses marques. Peut-être que la révolution permanente des formes commence à fatiguer… peut-être que l’industrialisation croissante du livre finit par enterrer la qualité sous la quantité… toujours est-il qu’on assiste, après le double effet d’une explosion ultime des formes — jusqu’à l’absurde — et d’une démultiplication de mouvement ridiculement intellectuels (post-réalisme, réalisme comique, réalisme grotesque, roman spéculatif, métafiction, et j’en passe), à un retour en force du roman traditionnel, non plus destiné à une élite, mais à un large public de consommateurs.
Il n’est plus possible pour un écrivain de la seconde moitié du XXè siècle de concevoir l’art comme une simple imitation du réel, émanant d’un auteur qui serait un observateur et un moralisateur dont la légitimité ne serait jamais contestée. Mais il ne lui est guère possible non plus d’enfermer l’art dans la tour d’ivoire des jeux linguistiques. C’est le paradoxe constitutif de l’esthétique post-moderniste : exhiber la « fictionnalité » de l’événement littéraire tout en établissant son inéluctabilité. Le postmodernisme qui caractérise le dernier quart de siècle part systématiquement du postulat que tout langage n’est jamais qu’une vision superflue du monde, et que toute vision n’est jamais qu’une version contestable de l’histoire. La question porte alors sur la validité des mises en intrigue, symptôme d’une culture profondément ébranlée dans son aptitude à la croyance et qui, plutôt que de porter le deuil du sens perdu, choisit de vivre l’expérience de la nécessité de l’erreur : culture de masse d’une société en crise et pourtant livrée à la consommation frénétique d’objets fétichisés.
(F. Regard, Histoire de la littérature anglaise)
J’avais initialement prévu d’en rester à la première moitié du vingtième siècle ; la littérature après les années cinquante devient trop vaste ; et puis, nous manquons de recul. Afin d’être complet, je citerai malgré tout quelques noms qui méritent bien leur place ici.
L’histoire se répète invariablement. Après le romantisme poétique, le néo-romantisme en poésie : c’est Dylan Thomas, sorte de poète maudit du pays de Galles ; après le néo-romantisme poétique, la réaction : c’est « The Movement » néo-classique, générateur de poèmes à la métrique rigide, mais prenant pour thème la vie de tous les jours. Larkin, figure de proue du « Movement », produit des poèmes fameux dans lesquels il décrit le quotidien avec réalisme. Si l’histoire se répète, l’histoire s’accélère, aussi ; les mouvements ne durent plus un siècle, mais dix ans ; à peine fondé, « The Movement » est déjà contesté : c’est maintenant « The New Poetry », poésie expérimentale qui reprend l’héritage du modernisme ! J’évoque au passage quelques voix singulières, inclassables, qu’il serait trop long d’analyser ; les poètes purs intéresseront de toute façon moins le public français, leur écriture étant par essence fondée sur la langue : Charles Tomlinson, Ted Hughes et Geoffrey Hill, John Montague, Seamus Heaney (prix Nobel 1995), Derek Mahon, Tom Paulin, Peter Reading, Douglas Dunn, Tony Harrison…
Le théâtre, à la fin des années cinquante, change radicalement sous l’influence des philosophes français ; au théâtre de boulevard succède d’une part un théâtre de l’absurde, d’autre part un théâtre politique. Samuel Beckett, que l’on connaît bien en France, est le représentant le plus célèbre du théâtre de l’absurde. Avec En attendant Godot, pièce sans vraiment de décor, sans vraiment d’intrigue et sans vraiment de dialogues cohérents, il achève de détruire dans une vaine révolution l’art sacré de Shakespeare. Breath, pièce écrite en 1969, n’est qu’un cri de trente secondes : la même année, Beckett a obtenu le prix Nobel. Beckett a fait des disciples : Pinter et Stoppard dont certaines œuvres, celles qui ne sont pas grevées de nonsense ou de silences, méritent que l’on s’y arrête.
Le théâtre politique s’est quant à lui, comme en France, engouffré dans une veine paradoxalement contestatrice et conservatrice, le nouveau conservatisme étant devenu contestataire après les traumatismes du vingtième siècle. John Osborne, Arnold Wesker, John Arden, Edward Bond crient leur colère sur les planches, et leur détestation d’une société capitaliste qui les subventionnent pourtant ; mais ils se fatiguent à la tâche et finissent rentiers confortables de leurs succès : symptôme du nouveau monde où le conservatisme rime avec Mal, et contestation sociale-libérale avec justice et bonté. « La conjonction d’un sentiment d’exaspération vis-à-vis des gouvernements, relève pudiquement F. Regard, d’une part, et d’une très large liberté d’expression, d’autre part, produit une situation propice à la créativité théâtrale, subventionnée depuis la fin de la guerre ». Après 1968, les dramaturges bien-pensants se donnent pour idée nouvelle de démocratiser le théâtre en le faisant descendre dans la rue, ce qu’on faisait depuis le moyen âge. Sans surprise, l’affaire n’aura pas duré longtemps (le peuple hélas n’est guère réceptif à la super-intellectualisation de l’art littéraire) : Hare, Berkoff, Griffiths se replient précipitamment dans les grandes scènes, à la radio et à la télévision. Je passe sur le théâtre trash « In-Yer-Face » qui agresse le spectateur : c’est dans la logique bien contemporaine de se révolter pour se révolter, à la sauce anglaise.
Faire un tour complet d’horizon du roman contemporain serait trop long ; je ne m’arrêterai que sur les quelques noms les plus connus. Anthony Powell, Lawrence Durrell (The Alexandria Quartet) remettent au goût du jour les grandes sagas. Barbara Pym, « au XXè siècle ce que Jane Austen était au XIXè » (E. Angel-Perez), revient de son côté au roman psychologique. William Golding, avec Lords of the Flies, ces enfants naufragés qui finissent par s’entre-tuer, « propose une version violemment iconoclaste du mythe de la robinsonnade » (F. Regard). Burgess propose quant à lui une vision dystopique du monde dans A Clockwork Orange, à l’origine du film de Stanley Kubrick. Je conclus avec Salman Rushdie, devenu malgré lui, après la publication des Satanic Verses, le symbole mondial de la lutte contre l’intégrisme religieux.
C’est par une œuvre satirique que S. Rushdie, issu de l’ancien empire colonial, amoureux de la liberté, s’est attiré les foudres des religieux les plus puritains : il est la synthèse parfaite de l’histoire de la littérature anglaise.
Lectures conseillées
- Regard, Frédéric, Histoire de la littérature anglaise
- Angel-Perez, Elisabeth, Histoire de la littérature anglaise
- Taine, Hippolyte, Histoire de la littérature anglaise